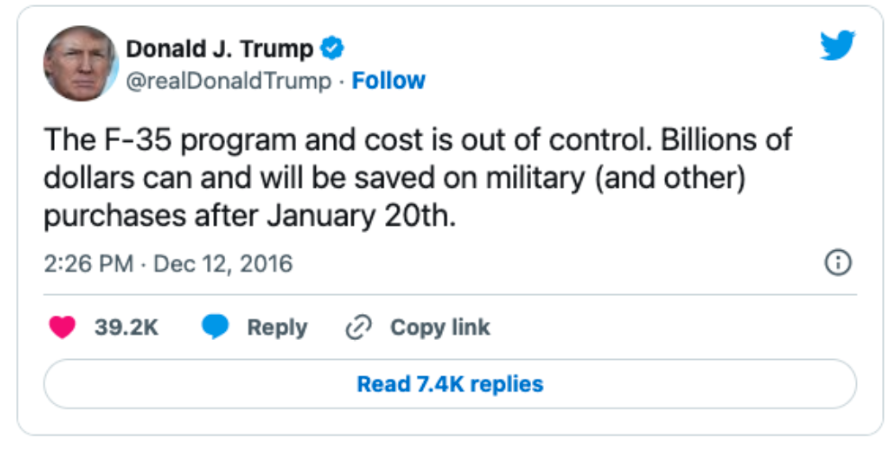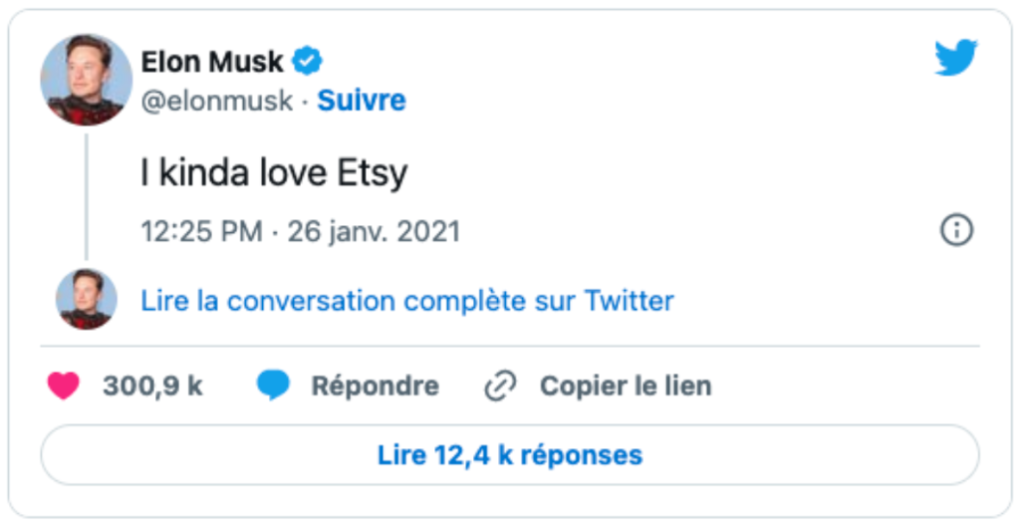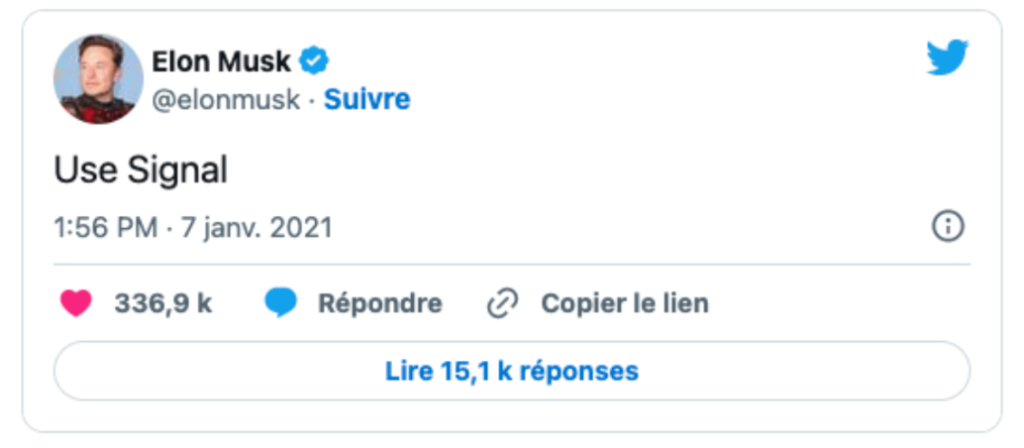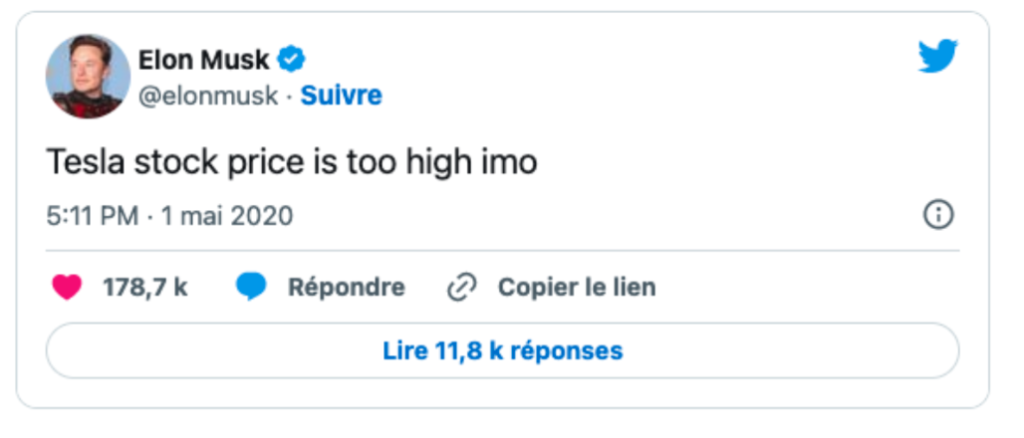EH&A : Quels sont les critères pour ouvrir une cellule de crise dans l’aéronautique ? Quels sont les outils, les moyens à votre disposition pour faire face à ces crises ?
Loïc Monguillon : La crise, ce sont tous les évènements qui ont eu, ou qui pourraient, dans leurs évolutions immédiates, avoir des impacts sur : d’abord la vie humaine (tout événement générant des blessés ou des décès parmi les clients ou les salariés, comme par exemple un accident aéronautique ou un acte terroriste, sur un avion ou dans un aéroport, doit immédiatement être perçu comme une crise majeure), mais on va également trouver comme critère de définition d’une crise dans l’aéronautique tout ce qui peut toucher aux moyens de production (c’est-à-dire ce qui peut empêcher les vols de se faire sereinement et en toute sécurité). De plus et de manière plus transverse, les enjeux réputationnels sont aussi facteurs de crise.
Chez Air France, on retrouve une cellule de crise centrale, c’est-à-dire corporate, qui s’active quel que soit l’évènement, qu’il soit à Paris ou ailleurs dans le monde. Il y a également des organisations de pilotage locales dans les aéroports impactés. Les profils au sein de la cellule de crise sont très variés, le but étant justement d’avoir un panel d’acteurs issus d’expertises différentes afin de mutualiser au mieux l’expérience de chacun. La réglementation et le droit aérien nous imposent des outils, notamment pour l’information aux familles et la coordination avec les autorités d’investigation. Une autre particularité de l’aérien aussi, c’est l’obligation d’assistance émotionnelle aux victimes ou à leurs proches. Cela signifie que l’on doit mettre à disposition des moyens humains pour accompagner ces personnes dans des moments difficiles. Cela implique de la préparation, de la documentation, de la formation et de l’entraînement. La coopération, les partenariats, que ce soit en interne ou en externe avec des autorités, des représentants des différents pays, sont au cœur de la gestion de crise dans ce secteur.
EH&A : L’anticipation de la crise est un critère important, comment anticipez-vous dans un contexte de crise évolutive ?
L. Monguillon : Selon moi, l’anticipation intervient à deux niveaux : avant que la crise ne se déclare et une fois que celle-ci est déclenchée. Tout d’abord, il convient d’essayer d’anticiper la crise avant que celle-ci ne se déclare. Pour ce faire, nous réalisons des analyses trimestrielles de crise, afin de prévoir ce qui pourrait impacter nos performances opérationnelles dans les trois prochains mois. Concrètement, on s’attend à voir dans les prochaines semaines des journées d’exploitation difficiles en raison des mouvements sociaux contre la réforme des retraites ou de phénomènes météo particuliers. Nous avons également une veille géopolitique : on nous fait remonter en interne les évènements qui pourraient remettre en question nos vols vers certaines régions du monde. Nous avons abordé les partenariats dans le secteur : les activations d’une cellule de crise restant heureusement relativement rares, nous avons du temps pour nous préparer et partager nos expériences avec d’autres organisations. Aussi, dès qu’une autre compagnie fait face à une crise, en particulier si nous n’avons pas traversé de crise similaire, nous allons analyser avec attention, les causes, les raisons, les actions mises en œuvre : on part du principe que ce qui est arrivé chez quelqu’un qui nous ressemble, peut aussi nous arriver. Malheureusement, la plupart des crises auxquelles nous avons dû faire face présentaient peu ou pas de signaux forts ou de signaux faibles.
Néanmoins la notion d’anticipation a également tout son sens une fois que la crise est déjà en cours (une grande partie de nos crises était des crises évolutives). A l’instar, d’une cyberattaque, d’une pandémie comme celle qu’on a vécu, d’un volcan islandais qui paralyse le ciel pendant un temps indéterminé, d’un acte terroriste, ce sont des crises évolutives avec des cinétiques différentes : pour un acte terroriste, cela sera une question d’heure ; pour une cyber attaque, une question de jours (voire plus probablement de semaines) ; une crise sanitaire peut durer plusieurs mois. Nous avons donc mis en place une cellule anticipation au sein de la salle de crise. C’est un groupe de 3-4 personnes à qui on va confier la mission d’envisager les scénarii d’évolution possibles de la crise en cours, et d’en préparer alors proactivement des éléments de riposte qu’il faudra déployer s’ils se concrétisent. C’est une fonction dont on s’est inspiré chez des partenaires comme EDF ou l’Armée, et qui nous permet d’avoir un coup d’avance.
Une fois une crise déclenchée, on n’hésite pas à contacter à nos partenaires de confiance, « l’appel à un ami ». Il y a des réseaux structurés comme le CDSE, et dans l’aérien, Air France fait partie de l’alliance Skyteam, qui rassemble 19 compagnies aériennes du monde entier. Par exemple, quand la crise Covid a commencé, nous avions la chance d’avoir des compagnies partenaires en Asie comme Vietnam Airline, China Eastern, China Southern, Garuda Indonesia, qui avaient dû s’organiser face à la crise avant nous. Leur retour d’expérience nous a été particulièrement utile, et nous avons pu à notre tour partager les nôtres avec nos partenaires sur le continent américain, où la pandémie est ensuite arrivée quelques semaines plus tard. Il est essentiel d’établir des partenariats en période de paix.
EH&A : Quelle est la place pour le facteur humain dans la gestion de crise ? Comment gérezvous ce facteur ?
L. Monguillon : La notion de facteur humain en gestion de crise est souvent sous-estimée. L’organisation de crise a souvent une approche très opérationnelle. Les outils de résolution de crise sont conçus par des humains et utilisés par des humains. Ils sont aussi appliqués dans l’urgence, c’est-à-dire dans le stress, parfois le chaos. La notion de facteur humain est ici primordiale et doit être intégrée dans les formations. Pour intégrer des méthodologies de gestion du facteur humain en situation de crise, nous nous sommes tout d’abord inspirés de ce qu’il se passe dans un cockpit. Les pilotes doivent faire face à des situations extraordinaires, au premier sens du terme. Un cockpit est donc une mini salle de crise et nos pilotes ont des compétences en termes de conscience de la situation, de prise de décisions etc…, que l’on peut retranscrire dans une salle de crise. On s’inspire donc de leurs expériences, notamment pour limiter certains biais cognitifs tel que le déni, la stupéfaction, … Typiquement, cela est un grand piège d’une salle de crise. Il faut se préparer à chaque éventualité.
EH&A : Le facteur humain est aussi au cœur de l’obligation d’assistance émotionnelle au sein d’Air France, pouvez-vous nous expliquer sa mise en place ?
L. Monguillon : Tout d’abord, c’est une obligation réglementaire du droit aérien international. Lorsqu’il y a un évènement qui fait des victimes, la compagnie aérienne doit apporter une assistance émotionnelle. Nous n’assistons pas seulement les familles des voyageurs décédés, mais aussi celles des blessés auprès de qui on doit continuer à assurer notre présence. Nous allons maintenir notre présence auprès des victimes dans les années qui suivent. De même pour les familles, certaines sont très fortement touchées, soit parce qu’elles ont appris la perte d’un proche, soit parce qu’elles ont cru un moment perdre leur proche. Deux organisations sont alors possibles selon les compagnies pour réaliser cette assistance : une grande partie ont choisi de le faire en interne. Au sein d’Air France, nous avons fait le choix de proposer à tout salarié de devenir volontaire pour venir porter assistance en cas de crise. Nous leur demandons par exemple les langues qu’ils pratiquent. Le jour où nous aurons besoin d’eux, nous serons dans l’urgence. Il nous faut un outil très structuré pour pouvoir contacter parmi nos 3 000 Volontaires ceux qui sont disponibles et les plus aptes à la mission qui leur sera proposée. La formation est nécessaire dans leur mission d’accompagnement des familles dans des phases de deuil, de traumatisme, de stress. Nous les formons aussi pour se protéger émotionnellement de ce qu’ils vont vivre. Nous avons une responsabilité en tant qu’employeur, nous demandons des choses à des personnes dont ce n’est pas le métier, ils sont volontaires, et subitement ils accompagnent en binôme une famille ou une victime qui a vécu quelque chose de dramatique.
EH&A : Air France a un partenariat avec Delta Airline et KLM, comment cette mutualisation des moyens vous permet d’apporter une réponse plus efficace face à la crise ?
L. Monguillon : Air France et KLM se sont associé dans les années 2003/2004 et Delta les a rejoints peu après dans un projet de mutualisation des plans de réponse en aéroport. Cela fait ainsi une vingtaine d’années que ce principe d’aide mutuelle a été mis en place, et que nous révisons nos procédures ensembles régulièrement.
Je vais donner un exemple virtuel. Prenons l’aéroport JFK de New-York, où les trois compagnies sont présentes. Il y a quelques vols air France et KLM (avec une équipe locale relativement réduite), et beaucoup de vols Delta Airlines (avec des équipes très larges). S’il y a un incident, concernant par exemple KLM au départ ou à l’arrivée de JFK, les équipes de KLM vont être très impactées, très sollicitées opérationnellement et émotionnellement. Elles auront pleins de choses à faire, apporter une assistance aux victimes, elles devront coopérer dans l’urgence avec les autorités, il y aura une très forte pression médiatique etc… Mais les actions qu’elles devront mettre en œuvre sont ni plus ni moins celles que les autres compagnies auraient eu à réaliser si l’accident était arrivé sur un de leur vol. Or, l’équipe de KLM est relativement limitée en nombre à JFK, ils auraient énormément de chose à faire alors que les équipes d’Air France et Delta à côté regarderaient ça de façon impuissante. Une mutualisation des forces est néanmoins envisageable. Il y a quelques années déjà Air France, Delta et KLM ont constaté que nous avions, dans chacun de nos aéroports, des organisations qui se superposaient quasiment parfaitement. Les trois compagnies ont convenu d’un plan local unique dans tous les aéroports où elles opèrent, dans un effort commun et conjoint. Audelà de ce plan, si l’une des compagnies est impactée par un événement majeur, les deux autres viennent en aide.
Le deuxième exemple, que j’aimerais vous partager, est un cas réel : l’attentat à l’aéroport de Bruxelles en 2016. Une des deux bombes a explosé dans la zone d’enregistrement de Delta, qui à ce moment enregistrait deux vols. Malgré la gravité de cet événement, il n’y a pas eu d’impact pour Air France. Immédiatement, s’est posée la question d’activer ou non une cellule de crise en prenant en compte les trois critères d’activation de celle-ci : l’atteinte à la vie humaine, l’atteinte aux moyens de production et l’atteinte à la réputation. Du point de vue d’Air France, la crise en cours ne répondait pas à ces critères. C’était dramatique et horrible, émotionnellement percutant, mais ce n’était pas une crise aux yeux d’Air France. De même pour KLM. Cependant, pour Delta, avec une bombe qui explose dans la zone d’enregistrement, ils ont dû activer leur organisation de réponse à la crise. Ils ont décidé de projeter une partie de leurs équipes vers Bruxelles pour continuer les missions. Il a fallu une journée entière aux équipes de Delta pour arriver à Bruxelles, ce qui reste un exploit dans une situation comme celle-ci. Nous autres, collègues d’Air France et KLM étions à quelques heures à peine en voiture. Aussi, par une triste coïncidence que Bruxelles est à la fois une ville flamande et wallonne donc les deux langues (français et néerlandais) qui étaient nécessaires pour faire une coordination locale. Ainsi, plusieurs personnes d’Air France et de KLM sont arrivées immédiatement. 2h30 après l’évènement, nous avions une armée constituée de personnels d’Air France et de KLM qui était sur place. Dans cette situation, l’union a vraiment fait la force.
EH&A : Est-ce que ce partenariat prend en compte l’assistance émotionnelle dont nous avons discuté ?
L. Monguillon : Bien sûr. C’est aussi un accord que nous avons entre Air France, Delta et KLM parce que cela fait plusieurs années que nous travaillons ensemble et que nous connaissons nos process. Cela s’applique aussi par convention avec les compagnies de l’alliance Skyteam constituée de dix-neuf compagnies. Nous avons un protocole d’engagement à l’assistance mutuelle en fonction de nos ressources disponibles. Cela permet aussi de faire la traduction ou l’interface avec les autorités d’investigation. L’assistance culturelle et linguistique est essentielle pour la traduction, l’accompagnement culturel, puisque le deuil s’exprime de façon différente selon les pays, pour les processus funéraires. Donc, oui, le partenariat sert beaucoup pour l’assistance humaine.
EH&A : Pour finir sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la gestion de crise, est-ce quelque chose qu’Air France a envisagé de mettre en place ?
L. Monguillon : L’IA intervient-elle dans la gestion de crise chez Air France ? Très peu. Il y a eu une digitalisation des outils, mais en même temps nous souhaitons volontairement rester très simples dans notre digitalisation, ne pas tomber dans la « gadgétisation ». Je serais ravi d’avoir un recueil de crises, qui constituerait une forme de base de données qui permettrait une aide à la décision regroupant d’anciennes situations ou expériences de tous secteurs. Une autre application d’IA qu’Air France n’a pas aujourd’hui, et qui pourrait être utile, serait l’identification immédiate des impacts d’une décision sur le plan juridique, assurantiel ou financier que nous pouvons prendre à chaud. Malgré les expertises que nous avons en salle de crise, nous n’avons pas forcément tous les tenants et aboutissants. Il y a eu des cas à chaud où nous avons pris une décision et nous sommes rendu compte à froid qu’elle avait des impacts juridiques, financiers ou assurantiels que nous avions sous-estimés ou négligés.
EH&A : Et pensez-vous que l’IA pourra complètement remplacer une cellule de crise ou estce que justement le facteur humain reste trop important pour que ce soit un algorithme qui le gère ?
L. Monguillon : J’ai du mal à envisager qu’un ordinateur puisse prendre la gestion complète d’une crise car je n’ai que des crises gérées par une intelligence humaine collective comme recul. J’ai à titre personnel une barrière psychologique pour l’envisager, mais si j’essaye de la franchir, je réalise que cela pourrait être envisageable. Je pense que l’IA est plus là pour gérer des continuités d’activité, pour coordonner des plans de continuité d’activités. On est dans la presque crise ou dans l’anticipation de la réponse à la crise. Mais cela serait peut-être dangereux de se dire que nous disposons d’une IA suffisamment développée pour gérer 100% des crises car l’un des principes d’une crise c’est d’accepter d’être surpris. Une IA se base sur des données et des expériences passées, il lui sera difficile d’anticiper ou de gérer une crise qui n’a jamais été pensée ou vécue. Un outil digital, quel qu’il soit, nécessite de penser à sa défectuosité : il peut tomber en panne, être hacké, mal configuré.
BIO :
IntLoïc Monguillon, Corporate Emergency Response General Manager / Risk management chez Air France
Loïc Monguillon débute sa carrière en tant qu’ingénieur pour différentes sociétés avant d’arriver chez Air France en 2000 en tant que responsable du suivi de l’exploitation. Après un an à Amsterdam chez KLM suite à la fusion avec Air France, il est chargé des projets communs entre les deux compagnies aériennes. De retour chez Air France, il devient manager des opérations. Depuis 8 ans, Loïc Monguillon est Directeur Général de l’intervention d’urgence. Il participe à la gestion des crises impliquant Air France ou ses différents partenaires. De la conception de plans d’actions locaux ou des centres de contrôle d’urgence de l’entreprise, il forme et gère ses équipes en amont, pendant et en aval des crises.
En octobre 2022, Loïc Monguillon co-signe avec Raphael de Vittoris Par delà la résilience et l’antifragilité : l’entreprise au XXIe siècle, qui propose des clés pour redessiner les organisations de façon innovante dans un monde volatil, incertain, complexe et ambigü.