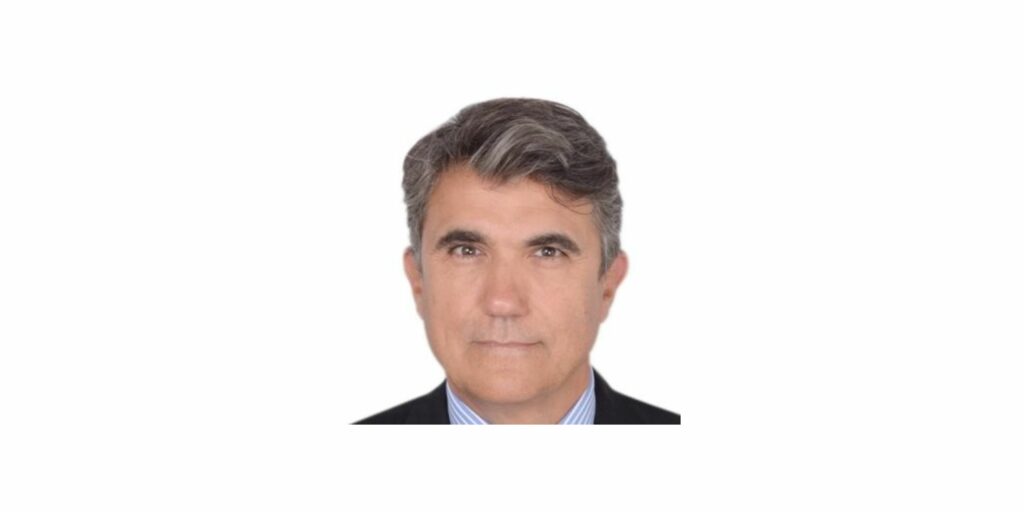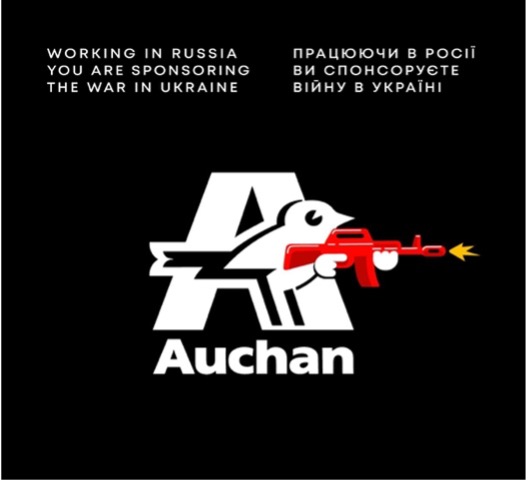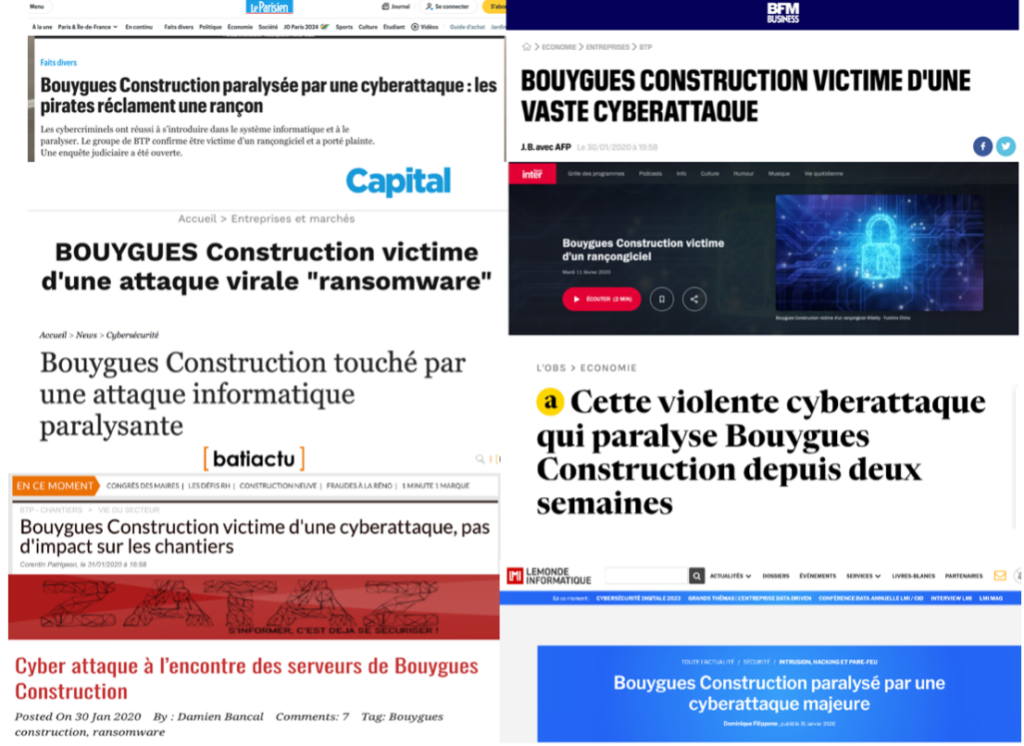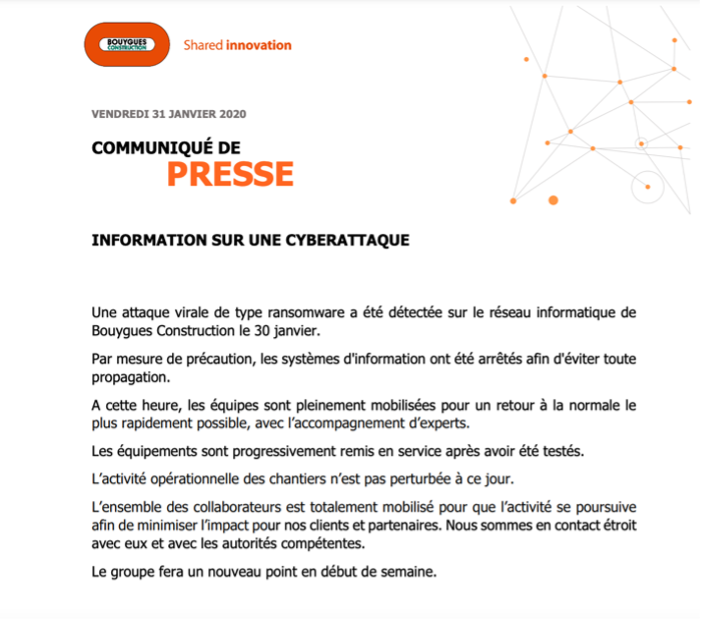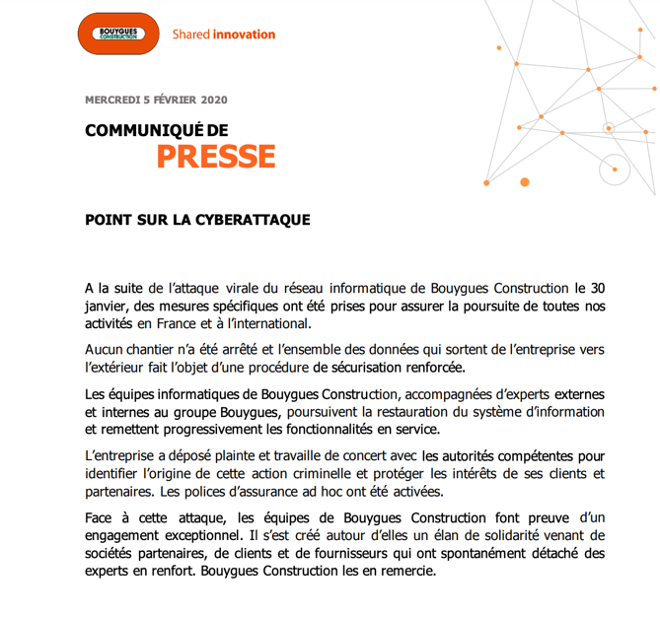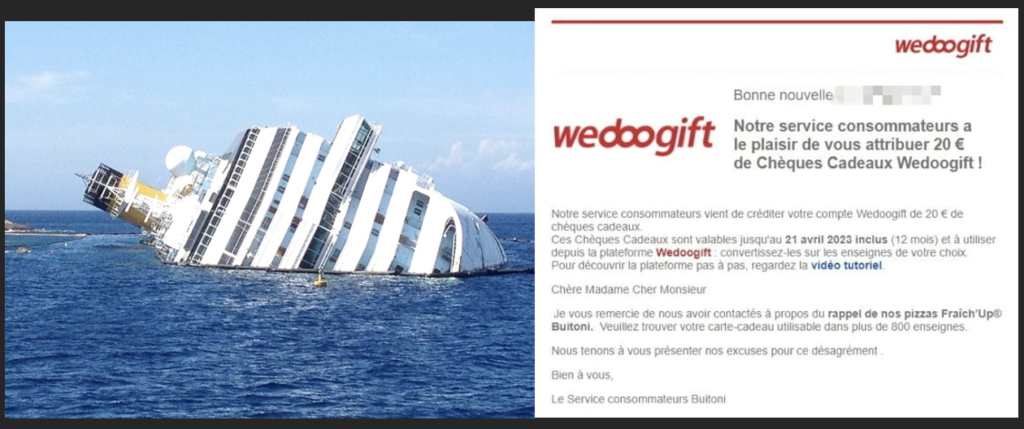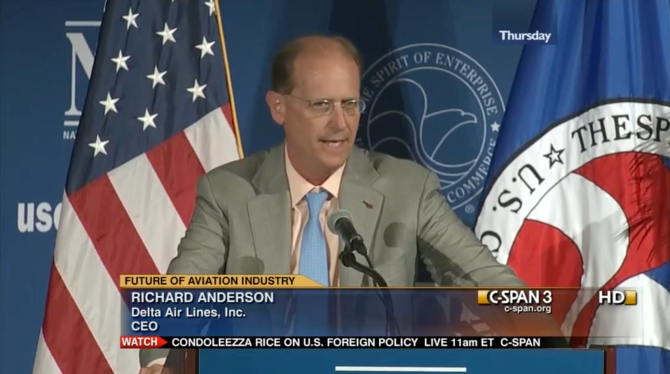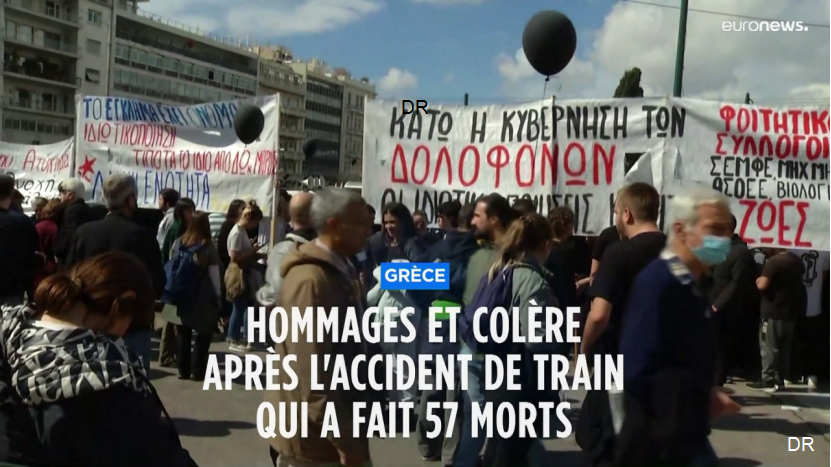Pouvez-vous vous présenter et présenter votre parcours ?
« Je suis le Vice-Amiral (2S) Charles-Henri Garié, Amiral de la Marine Nationale. J’ai fait 40 ans dans la Marine et 5 ans dans le privé et mon parcours se résume en trois mots : Marin, militaire et officier.
Militaire d’abord, car je suis un Amiral de la Marine Nationale, j’ai servi avec la notion du drapeau français et la défense de notre pays.
Marin, car sur quarante ans de Marine j’ai navigué environ 14 ans, sur des bateaux, de toutes sortes, notamment frégates et Porte-avions Charles de Gaulle.
Et enfin officier car en tant qu’Amiral, j’ai été cadre dirigeant.
En tant que cadre, j’ai occupé plusieurs postes, notamment responsable de tout l’entretien de la flotte à Toulon, à savoir les sous-marins nucléaires, le porte-avions etc. mais aussi à Paris, dans les postes stratégiques autour du Chef d’État-major des armées où j’étais en charge de la construction des armées de demain et de préparer les lois de programmation militaire.
J’ai terminé ma carrière en étant Amiral commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille avant de me consacrer depuis cinq ans à des fonctions de conseils et de gestion de projets dans le privé. »
Merci. Nous allons parler d’abord de votre expérience. Vous avez commandé pendant 5 ans les marins-pompiers de Marseille, quel était le périmètre de votre poste ?
« Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille est la plus grande unité de la Marine Nationale, avec un effectif de 2 400 marins-pompiers. Leur mission est d’assurer la sécurité des biens et des personnes de la deuxième ville de France. C’est environ 150 000 interventions par an, de toutes sortes, du blessé sur la voie publique au grand incendie.
Les Marins-Pompiers sont également chargés d’assurer la sécurité de l’aéroport de Marignane (5ème aéroport de France), du grand port de Marseille (plus grand port de France) et de l’usine Airbus, grande usine mondiale d’hélicoptères.
Les Marins-Pompiers sont placés sous les ordres du maire de Marseille : en tant que commandant, vous êtes à la fois chef militaire et chargé de la protection de la ville sous les ordres du Directeur Général des Services de la ville de Marseille. J’étais alors au cœur de l’administration d’une grande ville, ce qui a été passionnant et très formateur. »
Durant cette expérience, j’imagine que vous dû gérer différents types de crise, lesquelles ?
« Les crises sur lesquelles nous intervenons sont de toutes sortes et d’ampleur très différentes. En tant qu’Amiral, vous n’intervenez directement que sur les crises majeures. J’ai notamment contribué à la gestion de la crise des incendies ayant brûlé 3000 hectares de végétation, l’attentat en gare de Saint-Charles, l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne, pour n’en citer que quelques-unes. Ces crises, très différentes les unes des autres et provoquant des drames humains, sont souvent médiatisées et font intervenir de très nombreuses parties prenantes : autorités, riverains, élus…
En tant que commandant du bataillon, vous travaillez avec la préfecture, la région, le département, la ville, avec les autorités nationales, le ministère de l’intérieur, le ministère de la défense.«
Quelles étaient vos relations avec les élus ? Les entreprises ?
« Les relations avec les élus et les entreprises sont très intéressantes. Presque tout ce qui se construit ou se transforme à Marseille concerne les marins-pompiers, via les commissions de sécurité ou les demandes de permis de construire. Vous pouvez accompagner de grands projets, aider à trouver des solutions pour permettre la réalisation de ces projets en toute sécurité.
Avec les entreprises, un programme de formation et d’entrainement est mis en place, notamment par le biais d’exercices de simulation, dans le domaine de la mobilité urbaine avec la SNCF ou le réseau de bus par exemple, mais aussi avec des entreprises classées SEVESO, comme Arkema.
Il y a tout un travail d’anticipation et de réflexion à conduire sur les plans de protection et d’intervention entre la préfecture et les entreprises. Il est donc important d’établir des relations avec les directeurs d’usines ou de sites en amont des crises réelles, par le biais de ces entraînements. Cela permet de faciliter la gestion de la crise lorsqu’elle se déclare.
Les relations avec les élus sont différentes : vous commandez et coordonnez les opérations de secours sur le plan technique, opérationnel, sous la direction du maire ou du préfet qui dirige les opérations et prend les orientations stratégiques. Ainsi, la décision d’évacuation d’une maison de retraite relève par exemple des autorités tandis que la protection de la maison de retraite relève des pompiers.
Je suis d’ailleurs en train de travailler sur un projet d’école de formation des élus à la gestion de crise, avec le député de Toulon et le CNAM en région Provence Alpes Côte d’Azur.«
Ainsi, par votre expérience, vous vous êtes rendu compte que la gestion de crise nécessitait une vraie formation ?
« Totalement ! Prenez l’élu qui auparavant était chef d’entreprise ou instituteur par exemple. Une fois élu, il n’est plus dans la construction d’un programme, il devient responsable de la protection de la vie de ses administrés, ses décisions peuvent avoir un impact important et la transition est parfois compliquée. Prendre conscience de cela et savoir agir en conséquence n’est ni inné ni évident. Il en est de même pour les chefs d’entreprises, qui sont responsables de la protection de leurs salariés. Vous devez parfois faire face à des situations dans lesquelles des personnes meurent, sont grièvement blessées, où des familles sont dévastées.
Le passage de cette vie normale à la gestion de crise peut être très compliqué, et personne ne peut anticiper sa réaction. Il faut donc bien se connaitre et se former.«
Vous évoquez votre relation avec les entreprises en amont et pendant les crises. Pendant les crises, ces dernières vous voient elles comme un allié ou plutôt comme un censeur, un « inspecteur des travaux finis » ?
« Lors de crise réelle, je n’ai pas un seul souvenir d’une entreprise qui nous aurait pris pour des inspecteurs. Au contraire, les entreprises se mettent au service des pompiers.
L’entreprise dans son fonctionnement normal, dans la construction de son immeuble, de son hangar, de son usine, n’est pas toujours très facile parce qu’elle a des intérêts à défendre, ce qui est bien logique.
En revanche, quand on est en crise majeure, les entreprises coopèrent : nous avons besoin les uns des autres. On ne peut pas intervenir sur un feu dans une gigantesque usine sans l’aide du chef d’entreprise et de ses équipes ; et eux ne peuvent pas traiter et sauver leur entreprise et leur personnel sans nous. Il y a une vraie relation de coopération. Donc, je n’ai jamais vécu de telle situation, au contraire, j’ai souvent vu des chefs d’entreprise venir au PC, se présenter, venir aider et mettre des moyens à disposition.
Ces relations de confiance et cette bonne collaboration se construisent en amont. Dans ce monde de la crise, comme dans beaucoup d’autres, c’est le réseau que vous construisez qui va vous permettre de gérer au mieux.
C’est un des messages sur lequel je souhaite insister : entreprises, ne restez pas dans votre coin ! Vous avez des voisins, la police, les pompiers, la mairie, les administrations, des écoles, des établissements publics. En tant qu’entreprise vous devez prendre contact avec toutes ces parties prenantes, afin qu’elles soient des partenaires de confiance en cas de crise. Quand on connait ses interlocuteurs en temps de paix, la gestion de crise est facilitée.«
Avez-vous également participé à des exercices de grande ampleur ?
« Bien sûr ! Par exemple, sur le secteur de Marseille, il y a l’entreprise Airbus et l’aéroport de Marignane. Nous avons effectué des exercices de crash aériens, d’attentat dans l’aéroport ou dans les locaux de l’entreprise, des feux industriels. Avec le Stade Vélodrome, des exercices ont lieu également. C’est aussi le cas avec les entreprises, comme Arkema, avec lesquels sont déroulés les Plans Particulier d’Intervention par exemple.
D’autres exercices avec des risques bactériologiques ou chimiques pouvant engendrer des centaines de victimes ont lieu, parfois pendant 48h et faisant intervenir des figurants. Nous travaillons également sur le risque nucléaire.
Tous ces exercices sont construits et préparés en amont, avec les autorités, les élus, les entreprises, les fournisseurs de gaz ou d’électricité, la voierie etc. Cette préparation est fondamentale pour être au plus près de la réalité et conduire un exercice pertinent et utile. Plus le scénario est crédible, plus vous êtes prêts en cas de crise réelle.«
Avez-vous tiré des leçons de ces exercices de grande ampleur ?
« Bien sûr ! Lors des exercices, nous devons faire avec plusieurs grandes difficultés : une direction d’entreprise impliquée mais des échelons intermédiaires peu investis car peu consultés par la direction par exemple, ou encore une méconnaissance voire une ignorance des procédures. Très rapidement, les failles apparaissent : manque d’organisation, défaillance humaine, mauvaise communication interne comme externe, problème de délégation, de confiance.
C’est pour cela qu’il faut faire des exercices : Il est fondamental de bien se connaitre et de comprendre les enjeux d’une crise en amont.«
Vous avez également travaillé à l’État-Major des Armées pour préparer les armées du futur. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux entreprises concernant l’anticipation de crises ?
« Je vais faire un peu de philosophie du dirigeant. Si je devais conseiller un dirigeant j’utiliserais 3 mots : loin, large et profond.
Loin, car le dirigeant se doit de se projeter, d’anticiper, à court, à moyen et à long terme. Cette projection se fait logiquement et facilement pour développer les activités de l’entreprise. Il doit en être de même pour réfléchir aux risques et aux crises potentielles.
Large, car le dirigeant ne doit pas se focaliser uniquement sur la gestion des affaires courantes et quotidiennes. Le dirigeant doit prendre en compte son environnement, ses voisins, ses partenaires, la société civile, etc. Votre entourage est votre force en tant de crise, il est nécessaire de le connaître.
Enfin, profond vers le haut comme vers le bas.
Vers le haut car le dirigeant appartient à un système et doit connaître les sujets et préoccupations des élus et des autorités, afin que les sujets relatifs à son entreprise deviennent une de ces préoccupations.
Mais également vers le bas car plus le dirigeant monte en responsabilité, plus il s’éloigne des salariés les moins visibles. Or, ce sont la force de l’entreprise et les piliers en temps de crise. Il est fondamental de les connaître et de garder un lien. C’est avec eux et pour eux que vous travaillez.
Ainsi, le dirigeant doit donner un sens, une mission, un objectif, qui doivent guider les équipes afin qu’elles y adhèrent et se mobilisent. »
Dans votre grande expérience, est ce que vous avez vécu des crises qui vous ont marqué plus que d’autres par leurs difficultés ou leurs émotions ?
« Deux crises m’ont particulièrement marqué.
Lors des grands incendies partis de Rognac et qui s’étendaient jusqu’à Marseille, les éléments naturels qui se déchainent vous font prendre conscience de vos responsabilités. Les décisions prises engagent et auront des conséquences lourdes qu’il faudra assumer. Toute la ville de Marseille est dans la fumée de l’incendie, c’est extrêmement impressionnant. Et là, vous vous dites : « Le maire compte sur moi et j’ai la responsabilité de 800 000 habitants ». Ça marque les esprits.
De même, l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne est un souvenir lourd et très marquant. 8 personnes sont décédées. Nous avons passé cinq jours à chercher, à creuser, avec des chiens, à risquer la vie des marins-pompiers pour essayer de sauver des vies. Vous êtes face aux victimes, à leurs familles, à la presse, aux élus… Il y a des tas de gravats, il y a des gens, une course contre la montre et pendant ce temps-là les murs autour s’écroulent.
C’est cinq jours de tunnel incroyable, de richesse humaine mais également de drames. Une image me restera toujours : Nous avions vue sur les décors des appartements des immeubles effondrés. Dans l’un d’eux, deux cartables accrochés dans l’entrée d’un appartement du 3è étage, à 20m du sol, surplombants morts et gravats. Heureusement, les enfants vont bien, mais cela vous rappelle que la vie peut s’arrêter, brutalement, sans préavis… Très impressionnant. »
Donc ce qui marque le plus, ce qui est central, c’est l’humain ?
« Oui, philosophiquement parlant, notre vie de dirigeant c’est une affaire humaine. Vous ne dirigez pas des camions, vous ne dirigez pas des chaines de montage : vous dirigez des humains, avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs joies et leurs drames. Et s’il y a bien un endroit où il faut investir c’est sur l’humain : créer l’esprit d’équipage, créer l’esprit d’équipe, donner du sens.«
Quel est votre plus beau souvenir de ces expériences ?
« De toute ma carrière, mes plus beaux souvenirs sont les nuits que j’ai passé auprès des marins-pompiers, de caserne en caserne, dans les camions incendies ou auprès des secours. Ce sont cinq années de contacts humains aves des Hommes et des Femmes d’un courage fou et d’un dévouement exceptionnel, attentionnés, intervenant avec le même professionnalisme chez des gens en détresse, pauvres comme riches et dans des lieux parfois sordides. Des marins du feu prêts à donner leurs vies pour celles des autres, et de tout faire pour aider.
Les yeux heureux et brillants d’un pompier qui a aidé un bébé à naitre, à sauver une vie du feu ou de la noyade ; les yeux brillants de ce jeune qui a 20 ans, qui vient de sauver son ainé qui en a 50 ou 60 de plus, c’est une joie, c’est un moment extraordinaire.«
Quel est votre pire souvenir ?
« Toutes ces victimes, victimes de drames effrayants et très divers, victimes de la catastrophe qui survient, mais aussi victime des autres, des marchands de sommeil, des prédateurs, des voleurs, ils subissent tout. Des drames épouvantables, de pauvres gens, de gens perdus. Il y a de tout, il y a des gens qui abusent évidemment, il y a aussi des gens qui sont en détresse, des personnes âgées, des pauvres, des gens dans la rue, des SDF etc.
C’est cette misère humaine et ces drames humains marquants qui permettent de relativiser et de se dire qu’on est privilégié et qu’il faut aider. À la fois, on a de la chance quand on est en bonne santé et avec un toit sur la tête, mais cela permet également de mesurer la relativité des gens et du monde, ce qui nous donne envie de continuer à aider les autres.«
Auriez-vous des conseils en gestion de crise les plus fondamentaux ?
« J’ai 6 mots-clefs, 6 conseils à donner tout chef d’entreprise, à tout cadre-dirigeant, public ou privé pour la gestion de crise.
1/ Anticipation : trop d’entreprises n’ont pas réfléchi à ce qui pourrait leur arriver !
2/ Entraînement : l’improvisation « tue ». Personne n’est un surhomme et personne ne peut improviser en crise. La crise se gère correctement quand on l’a préparée, quand on s’est entrainé.
3/ Recul : un dirigeant doit prendre de la hauteur, du recul. En crise, c’est quelque chose de très difficile à faire, mais c’est essentiel. J’ai trop vu de dirigeants, de toute sorte, se perdre dans les détails et rentrer dans une effet tunnel et finalement perdre de vue l’essentiel.
4/ Se connaître : personne ne peut assurer avoir la bonne réaction en cas de crise. Un patron peut tout à fait être sidéré, tétanisé et ne pas être en mesure de prendre des décisions. Connaissez-vous, mettez-vous en situation de stress, travaillez sur vous, parce qu’au moment de la crise, tout votre équipage, tout votre personnel va vous regarder, toute votre entreprise va compter sur vous. Alors, ce n’est pas le moment de flancher.
5/ Equipage : cultivez l’esprit d’équipe. Ce n’est pas au moment de la crise que vous allez créer de la cohésion, c’est avant. Respectez les gens, encouragez-les, faites-les travailler avec vous, félicitez-les, travaillez la relation, connaissez-les sans faire d’inquisition, créez des occasions de cohésion et de détente, créez cet esprit d’équipage. Le jour où la crise survient, le collectif se met en mouvement derrière son capitaine.
6/ Communication : la communication, interne et externe, peut être le parent pauvre de la crise. On peut gérer une crise avec brio et planter son entreprise à cause d’une mauvaise communication. La communication est au service de la gestion de crise.«
Finalement, il y a beaucoup de similitudes entre votre expérience militaire et le privé ?
« Exactement. Souvent je parle de la solitude du chef. Quand je parle de la solitude du chef à un chef d’établissement scolaire, à un chef d’entreprise, un dirigeant, nous avons des points communs : vous êtes in fine la personne qui prend les décisions, qui engage, et tout le monde ou presque vous regarde. Vous n’avez pas intérêt à flancher.«
Dernière question, pensez-vous qu’il est nécessaire pour les entreprises d’être accompagnées ?
« Je pense que c’est même indispensable. Celui qui croit qu’il gère sa crise tout seul, qui va improviser le jour J, commet une faute lourde, souvent à cause de l’orgueil.
Ce n’est pas parce que l’on est a priori intelligent, qu’on sait diriger, qu’on a du bagou et que l’on connait son entreprise et son environnement que l’on va savoir gérer une crise. Donc c’est en se préparant, en s’entrainant et en se faisant aider avec des regards extérieurs, que l’on va comprendre et donc apprendre, y compris sur soi-même. Se faire aider par une entreprise extérieure et s’entrainer, se tester, être poussé parfois dans ses retranchements pour savoir comment on va réagir, c’est extrêmement important. »