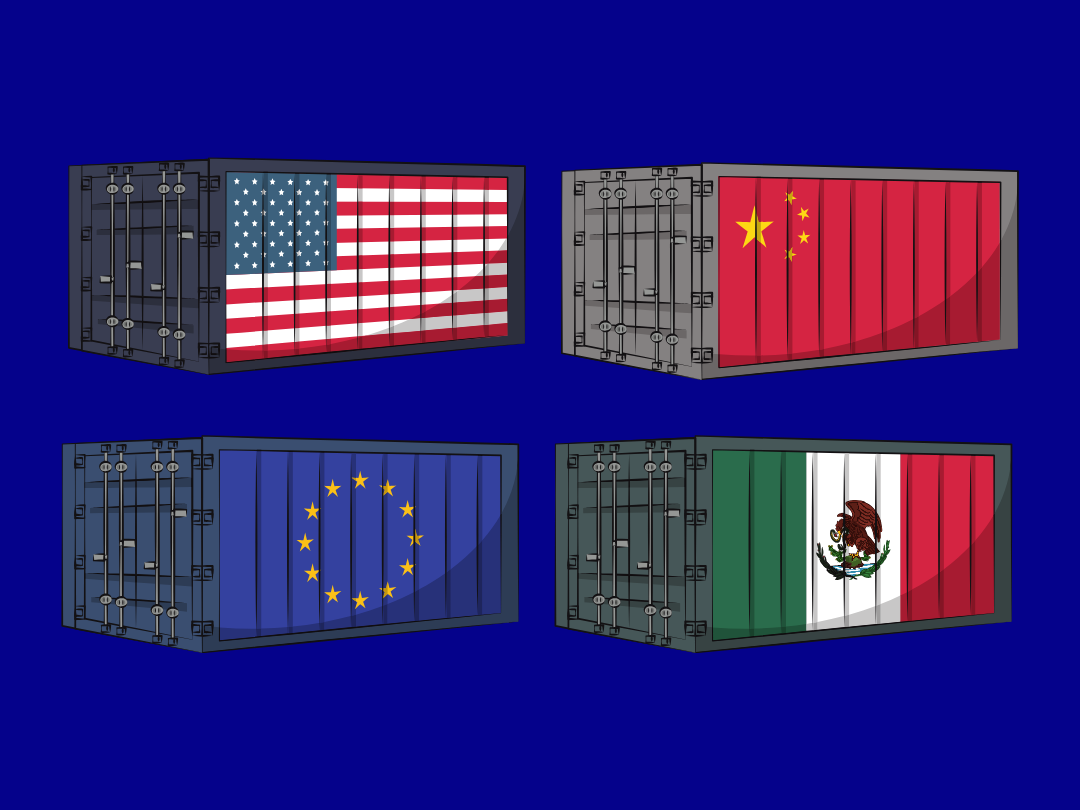Chaque mois, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours et leur expertise, nous offrent un point de vue singulier sur la crise. Ce mois-ci, notre “rencontre insolite” nous mène à Énora Chame : colonelle de l’Armée française, officier de renseignement, ancien officier des Forces Spéciales, et conférencière spécialisée dans les opérations spéciales, le renseignement militaire et la gestion du stress en situation de crise. Durant notre échange, elle nous a livré sa perception de la crise, et surtout sa conception de la gestion de crise.
Une anxiété collective qui paralyse
Depuis le COVID, Enora Chame observe une montée constante de l’angoisse dans la société. Les discours alarmistes sont devenus omniprésents : guerre, économie, réchauffement climatique, catastrophes… Ces récits, relayés en boucle, créent un climat émotionnel saturé.
Ce qu’elle dénonce, ce n’est pas la prise de conscience des risques, mais l’absence d’outils concrets mis à disposition des citoyens pour y faire face. Résultat : une société surinformée, mais sous-équipée. Le sentiment d’insécurité grandit sans que les individus se sentent davantage capables d’agir.
Face à cette angoisse entretenue, Enora Chame pose une question simple mais essentielle : pourquoi continuer à alerter sans jamais outiller ?
Revenir à l’action concrète
Face à cette paralysie, Enora Chame propose une approche radicalement différente : réinstaller l’action au cœur de la gestion de crise. Car la peur ne prépare pas — elle fige.
Elle parle de protocoles concrets, de procédures cognitivement adaptées aux personnels, et de gestes, simples, mais essentiels. Pas de plans abstraits ou de doctrines complexes. Elle prône une pédagogie du réel, reposant sur l’expérience et la répétition. Dans les premières heures de la crise :
- Intégrer des automatismes qui rassurent et permettent d’éviter ou de s’extraire de la sidération ou de l’agitation induites par un stress aigu dans les premiers moments de la crise : savoir où aller, trouver ses repères, s’organiser, qui appeler… Activer des réflexes ancrés par la répétition d’entrainements simples ;
- Créer des repères de proximité : famille, voisins, cercle immédiat, collaborateurs au sein d’une cellule de crise… ;
- Ensuite seulement passer à la mise en œuvre de procédures et de plans d’action dans le cas de crises connues ; dans les cas de crises de rupture, être soi-même en mesure et permettre à ses collaborateurs de déployer les ressources cognitives nécessaires au pilotage de situations encore inconnues (par exemple : effondrements systémiques en chaîne) et fortement anxiogènes.
Ces bases, souvent négligées, forment le socle d’une autonomie opérationnelle. Une préparation active, partagée, presque ordinaire — mais décisive le jour venu. Ces conseils peuvent être utilisés aussi bien par des particuliers que par des entreprises. « La peur n’évite pas le danger. On se calme, on traite les choses les unes après les autres. »
La crise, ce n’est pas quand ça dérape. C’est quand tu es dépassé
Pour Enora Chame, une crise ne se définit pas uniquement par son intensité ou son sujet, mais par le fait qu’elle dépasse nos ressources disponibles. Ce basculement peut être cognitif, humain, financier, matériel ou réputationnel. C’est à ce moment précis qu’on quitte le cadre de la gestion habituelle pour entrer dans un espace d’incertitude totale. Elle distingue deux types de crises:
- La crise résorbable : elle peut être traitée avec les outils et procédures existants, même si elle est inconfortable.
- La crise de rupture : plus rien ne tient. Les repères volent en éclats, les procédures s’effondrent, et il faut réinventer en temps réel.
Elle insiste sur le fait que ce type de crise ne déclenche pas uniquement des réponses opérationnelles, mais aussi une « sidération cognitive ». Elle compare la sidération des équipes face à une cyberattaque à celle vécue sur les terrains de guerre ou après un attentat : « Tu as beau avoir un super plan, quand tu es sidéré, tu ne sais plus comment te lever de ta chaise. »
C’est pourquoi, selon elle, la capacité à gérer une crise repose aussi sur la résilience mentale et collective, la connaissance de ses propres mécanismes de stress et la capacité à se réengager rapidement dans l’action.
Les premières heures sont cruciales
Pour Enora Chame, les toutes premières heures d’une crise – les quatre ou cinq premières – sont décisives. Elles constituent un moment de bascule où l’on peut, soit enclencher une dynamique de reprise, soit s’enfoncer dans le chaos.
Elle souligne que ces premières heures sont souvent mal gérées : les équipes cherchent leurs accès, ignorent qui contacter, et les procédures sont oubliées. C’est à ce moment-là que la sidération cognitive (état de choc paralysant ou agitation stérile) s’installe. « Il faut arriver à gérer les premières heures de façon à peu près digne », explique-t-elle.
Cela ne repose pas sur des plans complexes, mais sur des gestes élémentaires répétés à l’avance. Elle insiste : ce n’est pas au cœur du chaos qu’on doit découvrir où sont rangés les codes ou comment allumer son ordinateur. D’où l’importance des micro-drills : exercices courts, réguliers, ultra-concrets. Ils permettent aux équipes de retrouver rapidement leurs repères et de se mettre en mouvement :
- S’assurer que chacun sait où s’installer et comment accéder à ses outils
- Lancer une première action, même minime, pour mobiliser l’attention
- Identifier des gestes utiles et répétitifs qui rassurent
Ces micro-drills créent un socle de réflexes partagés. Contrairement aux grands exercices institutionnels souvent théoriques et trop rares, ils ancrent des pratiques simples dans le quotidien. Et c’est précisément ce type de routine qui fait la différence dans une cellule de crise. Elle conclut : « Ce sont des tâches assez simples, qui font sens, qui ne sont pas trop compliquées. C’est comme ça que l’on passe les premières heures. »
Le stress ne se contrôle pas, il se travaille
Une crise, c’est avant tout une situation de stress extrême. Et le stress, rappelle Enora, n’est pas un défaut moral ou une faiblesse individuelle : c’est une réaction biologique normale à une menace.
Le problème, c’est qu’il coupe l’accès à nos fonctions exécutives. On ne raisonne plus, on réagit mal, ou pas du tout. On entre dans la “sidération collective”. Pour y faire face, elle partage des stratégies concrètes de régulation du stress qu’elle enseigne en cellule de crise comme en formation terrain :
- Se recentrer physiquement et psychiquement : poser les pieds au sol, reprendre conscience de sa posture, réguler sa respiration
- Réaliser (et faire réaliser) de micro-tâches utiles : écrire une phrase au tableau, envoyer un SMS de vérification, cocher une étape
- Observer et stopper la contagion émotionnelle : neutraliser les leaders hyper-stressés, incarner un point d’ancrage pour les autres…
Former une cellule de crise, c’est aussi former chacun à connaître son stress, à l’anticiper, à l’apprivoiser, à le repousser. Elle compare cela à une préparation sportive : ce sont des gestes simples, mais leur puissance réside dans la répétition.
L’énergie du leader fait basculer la crise dans un sens ou dans l’autre
Enfin, dans une crise, la posture du leader est immédiatement perçue et reproduite par le groupe. Pour Enora Chame, il ne faut jamais sous-estimer la dimension émotionnelle collective. En effet, dans une cellule de crise ou dans une foule, l’émotion se démultiplie, elle se propage « Il n’y a rien de plus contagieux que l’émotion, la peur, la colère autour de soi. Quand on devient manager ou chef, il faut savoir ce qu’on est en train de diffuser comme énergie. » Si le leader perd ses moyens, l’effet domino est immédiat. Mais s’il incarne le calme, la clarté et l’action, cela peut désamorcer le chaos.
Elle partage des scènes vécues sur le terrain : des chefs figés, incapables d’avoir un mot ou un geste, laissant toute l’équipe en apesanteur. D’autres, au contraire, enclenchent une action simple mais structurante et permettent à chacun de sortir de la sidération.
Pour elle, le bon leader :
- Connaît ses propres signaux de stress et sait les réguler
- Donne des tâches concrètes, ciblées et utiles pour mobiliser sans surcharger
- Maintient une forme de calme actif, incarné, sans en faire trop
Elle insiste sur la contagion émotionnelle : ce que le leader montre est absorbé par l’équipe. C’est pourquoi sa posture énergétique devient un levier déterminant.
Former à la gestion de crise, c’est aussi former à ce leadership de présence : poser la voix, tenir la posture, respirer juste. Ce sont de petites choses qui évitent de grandes bascules.
À retenir :
✅ Reconnaître son stress pour mieux agir :
Comprendre comment le stress fonctionne permet de mieux le gérer et de limiter son impact négatif en situation réelle.
✅ Les petits gestes sauvent les grandes crises :
Les réflexes acquis lors d’exercices réguliers sont déterminants dans les premières heures d’une crise.
✅ Le calme du leader est communicatif :
La stabilité émotionnelle d’un leader a un effet immédiat sur la capacité collective à affronter une crise.