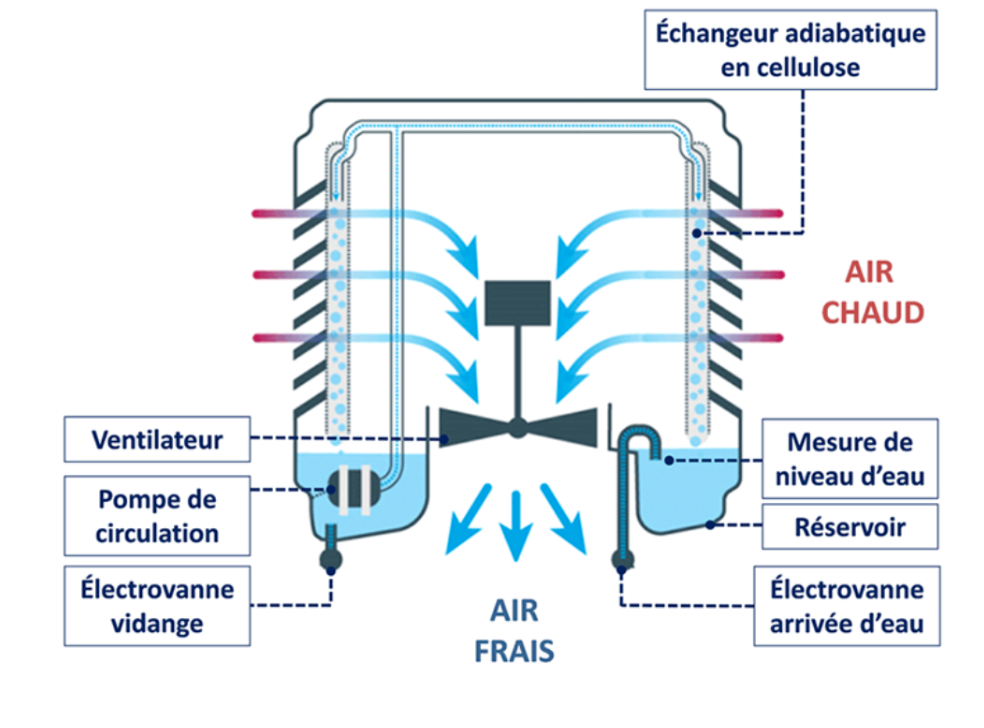La Shrinkflation, ce n’est pas le moment de se faire prendre !
Le saviez-vous fait un point aujourd’hui sur le phénomène de shrinkflation ou réduflation en français. Cette stratégie commerciale consiste à stabiliser ou augmenter le prix d’un produit tout en diminuant la quantité vendue. Cette méthode permet donc aux entreprises de dissimuler une hausse des prix en jouant sur la quantité. Si cette pratique fait polémique au sein des consommateurs, elle reste toutefois légale. Tant que l’information communiquée aux consommateurs est juste, les entreprises sont dans leur droit de changer le grammage ou le prix du produit en question. Les industriels agroalimentaires, cependant, ne commentent pas sur ces changements, seuls les étiquettes sont modifiées.
L’association Foodwatch dénonce cette pratique et demande aux industriels de faire preuve de transparence et de communiquer sur leur stratégie commerciale, sans quoi, le lien de confiance avec les consommateurs pourrait être définitivement rompu.
En avril 2018, au Maroc, un large mouvement s’est soulevé pour contester la hausse des prix de certains produits. Alors qu’au départ ni les autorités marocaines ni les entreprises ont pris ce soulèvement au sérieux, le mouvement a rapidement pris de l’ampleur et les entreprises ont vu leur chiffre d’affaires diminué drastiquement dans les mois qui ont suivi le boycott. L’un des P-DG s’est même rendu sur place pour essayer de régler le problème. Son entreprise décide alors d’une meilleure transparence des prix et des coûts de ses produits. Si ce cas marocain n’est pas un exemple de shrinkflation, il éclaire tout de même sur la façon dont la réputation d’une entreprise peut être entachée à travers sa politique commerciale. Aujourd’hui, de nombreuses personnes partagent et dénoncent sur les réseaux sociaux cette pratique de shrinkflation. Les produits et les marques, utilisant la méthode commerciale controversée, sont largement connus des consommateurs. Les risques de boycott et de bad buzz sont donc de plus en plus important d’autant plus que le contexte économique devient préoccupant. Plusieurs chaînes télévisées ont, par ailleurs, diffusées des reportages ou des émissions sur cette pratique. C’est le cas de France2 et de Capital sur M6.

En effet, si dans les supermarchés, le phénomène de shrinkflation se fait connaître petit à petit, le marché de l’énergie subit une crise similaire. La guerre en Ukraine et les sanctions mises en place contre la Russie ont contribué à cette difficulté d’approvisionnement de l’énergie et de hausse des prix. Le grand public a donc largement été informé par les autorités publiques de l’augmentation des coûts de l’énergie et des efforts à effectuer. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne incitent les citoyens à utiliser l’énergie de manière responsable. “Si nous savons faire des économies d’énergie partout, il n’y aura pas de rationnement et pas de coupure. Il n’y a pas de fatalité” a déclaré le Président français. GRTGaz a aussi ajouté que “des situations de tension pourraient toutefois se développer en cours d’hiver. Pour les prévenir, une sobriété en gaz et en électricité est indispensable dès maintenant afin de limiter les risques de réductions imposées de la consommation qui concerneraient seulement les grands consommateurs”.
La hausse combinée des produits du quotidien et de l’énergie provoque de nombreuses crisis sociales partout en Europe. Retour des “Gilets jaunes” en France, manifestation à Dublin ou encore en Allemagne. Au Royaume-Uni et en Italie, les citoyens ont décidé d’arrêter de payer leurs factures de gaz et d’électricité. Une pétition, du mouvement “Don’t pay UK”, a déjà été signée par 18 000 personnes.
Cette atmosphère anxiogène n’est pas en faveur des entreprises qui tentent d’augmenter leurs prix de façon dissimulée. Les consommateurs sont effectivement davantage renseignés et hésitent de moins en moins à partager leur mécontentement.
Dans le contexte économique déjà difficile, les entreprises prennent encore plus de risques en développant des stratégies commerciales controversées, pour leur réputation et donc leur chiffre d’affaires.